Rapport sur l'état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques du Québec 2020
Participez à la consultation publique
à optimiser nos outils de diffusion.
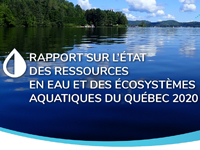 Consulter le
rapport
Consulter le
rapport
(![]() PDF,
102 Mo)
PDF,
102 Mo)![]()
Consulter le
rapport synthèse
(![]() PDF,
35 Mo)
PDF,
35 Mo)![]()
Téléchargez les documents pour bénéficier de l’ensemble de ses fonctionnalités
Le Rapport sur l'état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques
(![]() PDF,
102 Mo)
PDF,
102 Mo)![]() , publié à tous les cinq ans, permet d’établir une base commune de connaissances sur les conditions actuelles de l’eau et ses écosystèmes et sur leur évolution au fil du temps. Il met également en valeur l’expertise du gouvernement du Québec dans cette ressource qui fait partie de notre patrimoine commun.
, publié à tous les cinq ans, permet d’établir une base commune de connaissances sur les conditions actuelles de l’eau et ses écosystèmes et sur leur évolution au fil du temps. Il met également en valeur l’expertise du gouvernement du Québec dans cette ressource qui fait partie de notre patrimoine commun.
La description de l’état de l’eau et des écosystèmes aquatiques, au moyen de 43 indicateurs, présente les informations disponibles sur les eaux souterraines, les milieux humides, les lacs, les rivières, le fleuve, l’estuaire et le golfe Saint-Laurent ainsi que les milieux nordiques. De plus, le Rapport présente quatre fiches d’information, trois fiches décrivant les milieux nordiques et sept indicateurs en développement.
Dans le Rapport, on aborde les pressions exercées sur les ressources et leurs impacts, ainsi que les impacts potentiels des changements climatiques. L’information sur les mesures mises de l’avant par le gouvernement pour maintenir ou améliorer l’état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques sont également présentées.
Les conclusions du Rapport sur les enjeux liés à la qualité et la disponibilité de l’eau et à la protection des écosystèmes aquatiques permettent de mieux définir des priorités de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et orienter les actions pour une prise de décision éclairée en la matière.
L’Atlas de l’eau![]() permet de compléter le portrait de l’eau au Québec en fournissant une carte interactive des connaissances sur l’eau. Il est mis à jour régulièrement afin d’élargir les informations disponibles à de nouvelles thématiques et d’actualiser les connaissances qui sont en constante évolution.
permet de compléter le portrait de l’eau au Québec en fournissant une carte interactive des connaissances sur l’eau. Il est mis à jour régulièrement afin d’élargir les informations disponibles à de nouvelles thématiques et d’actualiser les connaissances qui sont en constante évolution.
Faits saillants
- Le portrait de l’état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques montre que 46 % des indicateurs sont positifs, notamment les aspects liés aux eaux souterraines et à certains paramètres de la qualité de l’eau du Saint-Laurent.
- L’état de certains indicateurs liés au Saint-Laurent est en amélioration depuis cinq ans.
- La quantité des ressources en eaux souterraines est bonne puisqu’aucun problème de disponibilité de la ressource d’importance n’a encore été signalé, bien que certains secteurs subissent des pressions liées aux prélèvements d’eau.
- Les plages participant au programme Environnement-Plage ont des cotes moyennes A (excellentes) et B (bonnes) pour la qualité bactériologique des eaux de baignade.
- La contamination de l’eau n’est pas préoccupante dans les cours d’eau du sud du Québec pour les métaux (aluminium, fer, cuivre, etc.) et dans le fleuve Saint-Laurent pour les PBDE (substance chimique ignifuge ajoutée aux produits de consommation pour éviter l’inflammation et la propagation des incendies).
- Ce sont 21 % des indicateurs qui démontrent un état détérioré, comme ceux qui sont liés à la qualité de l’eau en milieu agricole.
- Les rivières affichant un mauvais état des écosystèmes aquatiques et une mauvaise qualité de l’eau sont notamment influencées par l’agriculture.
- Dans les cours d’eau dont le bassin versant est principalement à vocation agricole et dans le lac Saint-Pierre, certains pesticides sont souvent en concentrations supérieures aux seuils de protection pour la vie aquatique.
- Dans les basses-terres du Saint-Laurent, la naturalité globale des cours d'eau est généralement faible, diminuant ainsi la capacité des rives à remplir leurs fonctions écologiques.
- Plus de la moitié des espèces indigènes de reptiles et d’amphibiens sont dans une situation précaire.
- La population de béluga de l’estuaire du Saint-Laurent est en mauvais état. La tendance historique au niveau de l’état de la population est à la baisse.
- L’état des populations d’omble chevalier anadrome est inquiétant pour les communautés inuites.
- Dans l’estuaire et le golfe, l’état de l’indicateur lié aux processus océanographiques (température de l’eau à différentes profondeurs, oxygène dissous et acidité) se détériore.
- Ce sont 33 % des indicateurs du Rapport qui sont classés intermédiaires.
- L’état se maintient pour 77 % des indicateurs du Rapport.
Rapport sur l’état de l’eau et des écosystèmes aquatiques au Québec - 2014
(![]() PDF, 10,8 Mo)
PDF, 10,8 Mo)![]()

